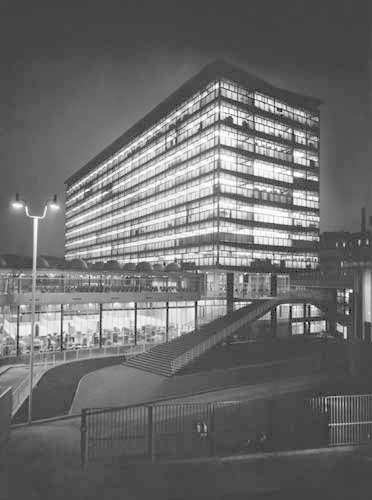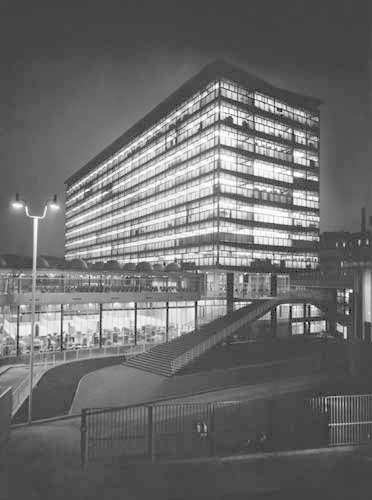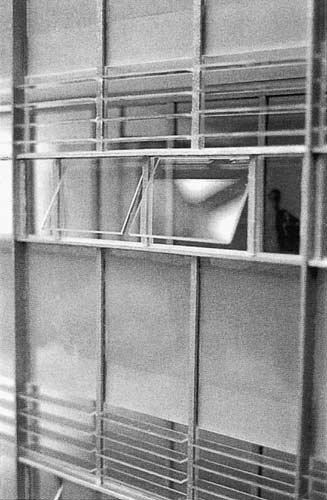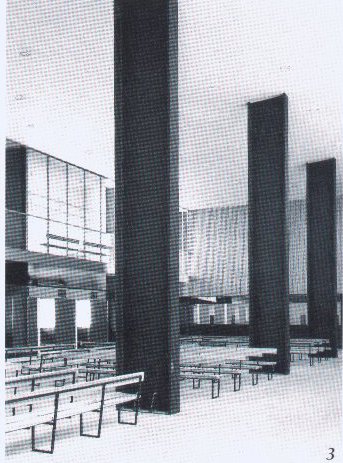Le
bâtiment est rétrogradé huit mois après son entrée
des monuments historiques par le tribunal administratif!
Lieu
:18, rue Viala, Paris 15ème,
Métro dupleix
Maître d'ouvrage : Caisse d'allocations familiales
de Paris. Maîtres d'œuvre : Raymond
Lopez (architecte), Marcel Réby (architecte de la CAF), assistés de Michel
Holley (architecte DPLG), Henri Longuepierre architecte DESA) et Simone Pillet-Lopez
(choix des couleurs). Entreprises : Schwartz-Hautmont
(charpente métallique béton armé, maçonnerie) ; Aluminex(menuiserie aluminium
des façades) ; Vitrex (panneaux de remplissage et coupoles en polyester stratifié
Héliotrex) ; Ateliers Wagons de Brignoud (cloisons mobiles).
Date de conception : 1953.
Dates de construction : 1955-1959.Superficie
: 25 000 m2. Usage initial
: bureaux administratifs et de direction, accueil
du public, services techniques, services de restauration, auditorium pour
4 500 agents Coût (valeur
1956-1958) : 1 600 MF. Restauration Maître d'ouvrage
: Caisse d'allocations familiales de Paris.
Bureau d'études : Reichen et Robert
1-Programme et Parti architectural
La Caisse centrale d'allocations familiales de la région parisienne a
été constituée en 1946 par la fusion
d'anciennes caisses professionnelles. Ses services étaient en effet disséminés
dans une douzaine d'immeubles lorsqu'elle demanda l'étude d'un bâtiment
supplémentaire. Le Programme était assez complexe du
fait des regroupements et éloignements nécessaires, il fallut donc construire
un immeuble de huit étages et de 1.500 m2
regroupant l'ensemble des bureaux et la réception du public ; un immeuble
indépendant d'un étage regroupant les services de mécanographie aux conditions
climatiques spéciales ; et enfin un autre immeuble
d'un étage contenant la médecine du travail et les bureaux de l'Administration,
de la Direction et du Conseil d'administration. Promis à la casse après quarante
en Pans de bons et loyaux services, l'immeuble de la CAF s'est trouvé au cœur
d'un vaste débat sur la notion même de patrimoine moderne. Inscrit à l'Inventaire
supplémentaire des monuments historiques en
1998, le bâtiment
est rétrogradé huit mois plus tard par le tribunal administratif. Le
ministère de la Culture fait alors appel de cette décision et sauve le bâtiment
de la ruine. L'ouvrage ne manque en effet pas de panache, avancé en proue
sur la rue et dressé sur deux files de poteaux qui trahissent la structure métallique
devenue l'objet d'un hommage unanime. À l'usage, l'immeuble
de la CAF subit vite le revers des innovations y qui firent
sensation. Les façades légères s'avèrent mal isolées et les piliers métalliques
incompatibles avec la réglementation sur les immeubles de grande hauteur
qui se met en place en 1965. À
défaut d'une mise en conformité, des sapeurs-pompiers y sont assignés à demeure.
En 1997 une étude
préalable de faisabilité de la réutilisation est lancée par appel d'offres par
le ministère de la Culture. Dans ce projet de réutilisation, dû à Reichen
et Robert, seul le bâtiment donnant sur la rue Saint Charles aurait été
démoli, tandis que de nouvelles constructions rues
Viala et Saint Charles auraient complété
l'ensemble.
Références
:
" La Caisse d'allocations familiales de Paris ", in Le Moniteur Architecture
AMC, n° 68, février. 1996, p. 108-112.
Dehan Philippe, " Quel avenir pour la CAF ? ", in Le Moniteur Architecture
AMC, n° 68, février. 1998, p. 113.
Robichon François, " Siège de la caisse d'allocations familiales de Paris
rue Viala, et voilà ", in D'architectures, n° 63, mars 1996, p. 14-16.
" L'immeuble parisien de la CAF en instance de protection ", in Le
Moniteur Architecture AMC, n° 92, oct. 1998.
in
Faces, nos 46-48, automne-hiver 1998-1999 [dossier et recueil d'articles
sur le thème de la transparence].
Sites
officiels:
www.patrimoine-xx.culture.gouv.fr
www.structurae.de.fr
Photographies
Yves marie Bohec
Les
cadres des grilles de façades des murs rideaux, exécutés en éléments tubulaires
rectangulaires d'alliage aluminium
Chaque huisserie reçut des panneaux de polyester de type Héliotrex, préparés
et mis en œuvre pour la première fois en Europe
sur ce bâtiment
En haut, le bâtiment tel qu'il était quelques années
après son inauguration.
En bas, le grand hall d'accueil du public avec sa hauteur sous plafond importante.
![]()
![]()
M5
Yves marie Bohec
Une
utilisation périlleuse de poutres Cantilever sur 8 étages
![]()
2-Aspects
Techniques
L'architecte choisit d'utiliser pour cette tour des matériaux
"à sec", industrialisés et préfabriqués, assemblés sur le chantier.
La structure avec porte-à-faux et l'amenuisement vers l'extérieur de
l'ossature répondaient à la conception des façades d'une extrême légèreté
et à un aménagement des plafonds favorable à l'éclairage naturel. La performance
est à l'époque exceptionnelle: huit niveaux de planchers métalliques
et une toiture inversée se découpent en porte à faux sur le ciel, leurs poutres
" Cantilever "effilées sont reprises sur un double alignement de poteaux.
Ce parti technique quelque peu acrobatique exigeait légèreté
et répartition équilibrée des charges, notamment dans les planchers
très légers réalisés en tôle nervurée avec isolation intégrée, les plafonds
suspendus en tôle perforée, et les cloisons mobiles fixées par
vérins au plafond. Le mur-rideau est quant à lui suspendu par des façades
est en aluminium, alternant vitrage et parties pleines en polyester. Les cadres
des grilles de façades des murs rideaux, exécutés en éléments tubulaires rectangulaires
d'alliage aluminium, furent fixés aux extrémités
des consoles de chaque plancher. Chaque huisserie
reçut des panneaux de polyester de type Héliotrex, préparés et mis en
œuvre pour la première fois en Europe sur ce bâtiment. Le polyester rentrait
également dans la composition des cloisons mobiles et des coupoles l'éclairage
bleutées d'une partie de la couverture. Enfin, il faut noter que la pose
de pare-soleil en bardage d'aluminium sur les panneaux
de polyester, dès 1960, ne réussit pas à pallier l'absence originelle de climatisation.
3-Commentaires
Il est très clair que ce bâtiment dans son ensemble a mal vieilli,
la façade du bâtiment principal, en particulier, a énormément souffert de
ses innovations technologiques ces dernières années. Toutefois, on ne peut
pas nier une certaine pureté dans ce système
général qui par sa capacité technique permettait pour l'époque d'obtenir une
élévation très lumineuse.
Des
cloisons mobiles fixées par vérins au plafond
Des
plafonds suspendus en tôle perforée
des
huisseries avec des panneaux de polyester de type
Héliotrex,